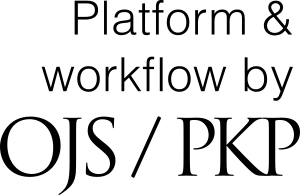Archives
-

Variations pronominales
Vol. 16 No 1 (2025)Ce numéro de L’Atelier se propose d’examiner les enjeux – anciens et nouveaux – qu’induit le choix du pronom dans le récit et, plus largement, au sein de la création littéraire. Kafka, selon Maurice Blanchot, est un de ceux qui « nous apprend que raconter met en jeu le neutre », neutre porté par un « ‘il’ incaractérisable », « une troisième personne qui n’est pas une troisième personne » ou encore un autre « qui n’est ni l’un ni l’autre ». En même temps qu’il suspend le rapport au référent, le récit instaure une indétermination qui concerne aussi bien la voix narrative que les sujets qu’il fait exister ; il ouvre un espace où la référence pronominale se voit livrée à une instabilité fondamentale. Le choix du pronom se dote d’un pouvoir proprement poétique à travers lequel peuvent s’explorer différentes postures subjectives et intersubjectives mais qui relève aussi de ce que Blanchot nomme « l’événement inéclairé de ce qui a lieu lorsqu’on raconte ».
On pourra s’intéresser à la dissociation entre forme pronominale et fonction pragmatique dans les récits jouant sur une ambiguïté référentielle : le même pronom peut renvoyer à deux entités distinctes ou inversement une même entité pourra se désigner par deux pronoms différents. A quoi ces glissements pronominaux œuvrent-ils ? A quelles fins la déconnection entre forme grammaticale et forme notionnelle peut-elle être exploitée ? La disjonction pronominale peut, sur un mode mimétique, se mettre au service d’un trouble ou d’une défaillance psychique, d’un traumatisme, d’une schize. Le passage de la première personne à la deuxième ou à la troisième personne peut dramatiser un sentiment d’étrangeté ou un phénomène de dissociation et perturber ce faisant les catégories narratives traditionnelles. Reste à envisager en quoi le choix de faire le récit à telle ou telle « personne » dépasse la question de la personne, de l’identité ou de l’identification, notamment dans les récits qui troublent ou mettent à mal l’illusion référentielle.
— Numéro coordonné par Sandrine Sorlin et Pascale Tollance
-
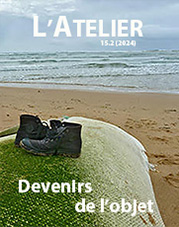
Devenirs de l'objet
Vol. 15 No 2 (2024)Si l’objet a pour caractéristique d’intéresser une grande variété de champs disciplinaires allant de l’anthropologie à la philosophie, de l’ingénierie à l’histoire de l’art, de la sémiotique aux études culturelles, son importance ne va pas d’emblée de soi dans les sciences humaines où il s’agit de penser en premier lieu l’homme ou le sujet. Là, tout comme dans les arts ou la littérature, parler de l’objet revient en premier lieu à considérer la place qui lui est faite dès lors qu’il se pose non seulement en relation mais potentiellement en concurrence avec le sujet humain. On pourrait dessiner un devenir de l’objet qui le ferait passer de l’ombre à la lumière : admis dans le champ du visible, l’objet peut cesser d’être un élément du décor ou un détail anodin pour devenir un élément troublant et perturbateur, chargé de sens, tenant intimement celui qui croit le (dé)tenir, jusqu’au moment où il rayonne, triomphe seul et devient le « sujet » même du tableau, du poème ou du récit. Alors que nous sommes invités à penser toujours davantage le non-humain et le post-humain, la littérature et les arts opèrent ou accentuent ce geste paradoxal qui consiste à offrir à la contemplation un objet qui ne doit rien à une main humaine et qui survit à l’humain ou se transforme indépendamment de tout regard.
— Numéro coordonné par Marie Olivier, Pascale Tollance et Anne Ullmo
-
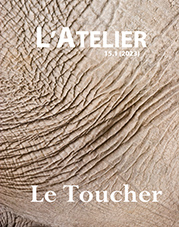
Le Toucher
Vol. 15 No 1 (2023)Si l’expérience tactile se situe en dehors des mots, et peut même en constituer un substitut, la rhétorique du toucher appartient au langage ordinaire. Le toucher est un « trope quelconque », inscrit dans les tournures communes de l’affect, de la pensée et de la communication. C’est à ce titre, selon Jacques Derrida, que le toucher présuppose d’emblée son absence. Dès lors que le toucher compose un « corpus » de figures, l’immédiateté de sa présence est interrompue : « il n’y a pas ‘le’ toucher ». Réfutant l’intuition du sens commun et l’entrelacs phénoménologique, Derrida, après Jean-Luc Nancy, arrime le toucher à l’intouchable.
Cette approche figurale du toucher désigne le texte littéraire comme une modalité privilégiée de l’haptique, tout en l’éloignant du toucher proximal. La littérature, au même titre qu’une technologie haptique, met en œuvre diverses formes de toucher virtuel. Faut-il pour autant réduire le toucher à une figure ? Dans le texte littéraire, la limite entre métaphore et métonymie tactiles est d’ailleurs souvent floue : comment renouveler cette compréhension rhétorique du toucher ? Tout en mesurant l’apport des théories poststructuralistes de l’haptique proposées par Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy, ce numéro vise à réévaluer les manières dont le texte littéraire appréhende « le toucher » comme une expérience sensible et affective à part entière. La littérature restitue et imagine des récits incarnés, des scènes haptiques, des corps touchants et touchés où l’enveloppe de la peau évoque, jusque dans « l’intimité du muqueux » (Luce Irigaray), une présence corporelle réflexive.
— Numéro coordonné par Marie Laniel et Caroline Pollentier
-
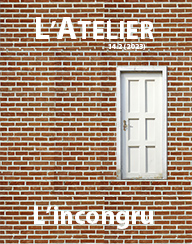
L'Incongru
Vol. 14 No 2 (2023)Inattendu, surprenant, parfois déplacé ou inconvenant, l’incongru contrevient aux usages tant esthétiques que moraux ou linguistiques et déroge à la norme, qu’elle soit sociale, narrative ou intellectuelle. Surgissement d’un désordre, l’incongru agit comme un punctum qui vient faire saillie dans « l’étendue, […] l’extension d’un champ que je perçois assez familièrement en fonction de mon savoir, de ma culture » (Roland Barthes, La Chambre claire, 47). Il arrête le regard, le décale, ébranle l’équilibre qui puise sa source dans un familier construit par un savoir, une culture, des attentes. En d’autres termes, il fait effet et déclenche des émotions auxquelles les lecteurs ou spectateurs n’étaient pas nécessairement préparés : étonnement, lorsque par exemple un détail inattendu vient infléchir le cours d’une narration, rire, lorsque se produisent des décalages qui dérèglent la machine, effroi aussi parfois, lorsque le non familier vient bousculer la compréhension du monde. Comme le suggère le préfixe -in, l’incongru apparaît comme une paradoxale soustraction, ce qui vient s’opposer à la convenance, en priver l’instant, tant sur le plan quantitatif que moral et le fait en se parant d’un supplément visuel, sonore, sémantique. Il vient faire effraction dans le sens dont il perturbe la construction et la compréhension en exhibant une disjonction bien souvent sensorielle, en créant la dissonance, en pratiquant des sauts de registres dans lesquels se manifeste parfois un inconscient dont les rêves mettent à mal toute unité ou pensée close de la réalité.
— Numéro coordonné par Sylvie Bauer et Juliana Lopoukhine
-

Le Transfert
Vol. 14 No 1 (2022)Dimension clé de la cure analytique, le transfert est la réactivation de pulsions inconscientes infantiles insues, qui sont adressées à la personne de l’analyste. Dans ce processus, référent, canal, destinataire et même code sont tous sujets à des déplacements, transpositions ou substitutions : le transfert est à la fois dé- et re-contextualisation, réactualisation temporelle ; l’analyste et son cabinet deviennent acteur et théâtre, la cure le medium dans lequel l’analysant s’exprime. Découverte accidentellement par Freud dans la cure de Dora, cette situation où l’on répète en transposant pourrait servir de modèle théorique au processus créatif à l’œuvre dans la littérature, le cinéma ou dans le contexte des « media studies ». Peut-on envisager que cette double impulsion, à redire et à répéter sous une forme autre ou insue, à faire glisser codes et modalités, soit au cœur de l’acte d’écriture ou de création artistique ? Par quels jeux de substitutions, déplacements, et métonymies un medium fonctionne-t-il ?
Toujours présent inconsciemment dès l’établissement du rapport entre analyste et analysant, le transfert peut être l’occasion de résistance, de conflit. Dans quelle mesure l’écriture ou la création artistique mettent-elles en œuvre des processus comparables aux processus transférentiels ? Quels malaises et forces appellent à la répétition et la remise en jeu ? Si le transfert est un moment-seuil, peut-il être franchi et dépassé, et quel est son devenir ? On pourrait questionner en particulier le rapport entre trauma et transfert.
— Numéro coordonné par Isabelle Alfandary, Priyanka Deshmukh et Samuel Weber
-

Trouble dans la théorie
Vol. 13 No 2 (2022)Ce 25ème numéro de L’Atelier se propose de faire le point sur l’état de la critique dans le champ des études littéraires et d’examiner comment une théorie de plus en plus protéiforme accompagne aujourd’hui nos pratiques de lecture. L’ambition n’est pas de répertorier l’ensemble des tendances ou « tournants » qui s’affirment çà et là, tâche redoutable si l’on se réfère au diagramme que Vincent B. Leitch place au début de son ouvrage Literary Criticism in the 21st Century (2014) et qui ne répertorie pas moins de 94 sous-champs répartis à l’intérieur de 12 champs théoriques principaux. Conformément à la vocation métacritique de la revue, il s’agira plutôt d’interroger les phénomènes eux-mêmes – phénomènes d’émergence, de déclin, de mutation, de persistance ou de résilience de certaines approches théoriques – de prendre en compte le terreau dans lequel ils s’ancrent, leur moteur et leurs enjeux. Alors que les humanités et les études littéraires se sentent de plus en plus menacées dans leur existence même, on pourra s’intéresser à la façon dont continue de s’affirmer la spécificité scientifique mais aussi la valeur éthique et politique du travail dans lequel nous engage la littérature. Fidèles à ce qui constitue notre ligne éditoriale, il s’agira plus que jamais d’envisager de quelle façon la critique, quelle que soit la théorie qui la nourrisse, « s’explique avec la littérature plutôt qu’elle ne s’applique à elle ».
— Numéro coordonné par Marie Laniel, Pascale Tollance et Anne Ullmo
-

Lieux communs 2
Vol. 13 No 1 (2021)Au fil de la réflexion sur la communauté que la pensée philosophique et politique a menée avec une intensité marquante depuis les années 80, s’affirme la nécessité de distinguer le « commun » et le « communautaire » et de penser la communauté contre les écueils – ou les ravages – d’une hypothétique communion. Le « lieu commun » dans cette perspective ne se maintient qu’à la condition qu’il ne cesse jamais de se désirer et de se chercher dans un « entre » qui ne saurait être aboli. Ce que la langue courante désigne pour sa part par « lieu commun » témoigne d’une fixité qui, si elle peut sembler rassurante, tend à être plutôt ressentie comme sclérosante : le « lieu commun » ne s’oppose pas seulement à toute idée d’originalité mais, plus encore, charrie un savoir qui s’énonce machinalement, sans se penser. Loin d’être étrangères à la question de « l’être-avec », ces formules toutes faites qui habitent la langue et font buter la parole sur sa propre limite nous interrogent sur les formes de partage qui s’instaurent dans l’espace commun. À ce point, deux questions convergent et se recouvrent : l’idée que le dire doit s’arranger avec un dit déjà constitué est indissociable de l’articulation entre un je et un nous.
— Numéro coordonné par Marie Laniel et Pascale Tollance
-

Lieux communs 1
Vol. 12 No 2 (2020)Au fil de la réflexion sur la communauté que la pensée philosophique et politique a menée avec une intensité marquante depuis les années 80, s’affirme la nécessité de distinguer le « commun » et le « communautaire » et de penser la communauté contre les écueils – ou les ravages – d’une hypothétique communion. Le « lieu commun » dans cette perspective ne se maintient qu’à la condition qu’il ne cesse jamais de se désirer et de se chercher dans un « entre » qui ne saurait être aboli. Ce que la langue courante désigne pour sa part par « lieu commun » témoigne d’une fixité qui, si elle peut sembler rassurante, tend à être plutôt ressentie comme sclérosante : le « lieu commun » ne s’oppose pas seulement à toute idée d’originalité mais, plus encore, charrie un savoir qui s’énonce machinalement, sans se penser. Loin d’être étrangères à la question de « l’être-avec », ces formules toutes faites qui habitent la langue et font buter la parole sur sa propre limite nous interrogent sur les formes de partage qui s’instaurent dans l’espace commun. À ce point, deux questions convergent et se recouvrent : l’idée que le dire doit s’arranger avec un dit déjà constitué est indissociable de l’articulation entre un je et un nous.
— Numéro coordonné par Marie Laniel et Pascale Tollance
-
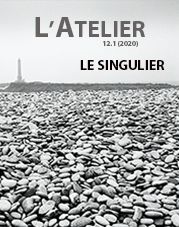
Le Singulier
Vol. 12 No 1 (2020)Le singulier appelle la distinction, la différenciation. Repérer une singularité, c’est souligner ce qui marque l’objet appréhendé comme autre, comme impossible à contenir dans des catégories préétablies. Si le singulier est ce qui semble pouvoir n’être appréhendé qu’en lui-même, la coexistence, l’« être-avec », sont les conditions de son appréhension. Étudier la singularité, ce peut être pointer du doigt l’exceptionnel, faire de l’adjectif singulier un euphémisme traduisant l’intuition d’une altérité radicale ou désigner ce que, par manque de reconnaissance, l’on exclut. Le singulier, s’il ne peut, pour Jean-Luc Nancy, être pensé que dans sa relation à l’être-avec, ne semble pouvoir être réduit à du tout autre. Giorgio Agamben, en évoquant une « singularité quelconque », détachée de toute appartenance identitaire et d’une société qui pourrait la reconnaître, en évoquant la singularité de « l’être qui vient », évoque aussi l’impossibilité de réduire le singulier à une position et la nécessité de l’accepter comme advenue.
Dans le champ de la littérature, il s’agira à la fois d’appréhender la singularité d’un style, d’une voix, d’une écriture, et d’envisager comment chaque nouvelle œuvre donne lieu au monde, se fait singulière « origine » d’un monde toujours en partage. Comment la création d'un personnage de fiction singulier permet-elle, par exemple, d'interroger la normalité, voire de la mettre en déroute, en suggérant une autre manière d'être au monde, de voir le monde ? Comment la littérature peut-elle représenter l’événement dans la singularité de ce qu’il ne répète pas ? La littérature, en tant qu’elle crée, à partir d’un langage commun, une parole singulière, témoigne de la manière dont le langage se singularise, créant du singulier à partir de signes qui, dès leur apparition, ne laissent « aucune chance de rencontrer quelque part la pureté de la “réalité”, de l’“unicité”, de la “singularité” » (J. Derrida, De la Grammatologie, 139). Comment la littérature devient-elle, par la singularité de son idiome, le lieu privilégié d’une interrogation profonde de nos fondements ontologiques et sociétaux, et d’une réaffirmation de « l’être-avec » de multiples singularités ? Comment la singularité d’une écriture, qui ne peut être réduite à un discours supplémentaire sur le monde, déroute-t-elle les tentatives de récupération qui pèsent sur le littéraire ?
— Numéro coordonné par Amélie Ducroux et Marie Olivier
-

Référence et référentialité 2
Vol. 11 No 2 (2019)De quoi parle la littérature ? La littérature parle-t-elle de quelque chose ? La théorie aristotélicienne de la mimesis pose celle du rapport référentiel entre objet et représentation, entre monde et langage. Si pour Saussure le langage met fin au monde dans l’avènement ou la survenue du signe, est-il encore possible de dire qu’écrire, c’est décrire, ou même donner forme au monde, à l’expérience du monde ? Alors qu’il postule la préexistence d’un système de références stable comme pacte de lecture – lieux, événements, personnages, contexte historique et culturel – dont le texte littéraire se saisirait pour devenir l’espace métonymique d’un temps historique, le prisme référentiel tient-il encore face au pouvoir radical du langage, et à ce que ce pouvoir fait au monde ?
Ce numéro de l’Atelier souhaite interroger l’écriture comme médiation, comme ce qui arrive au monde, sa capacité à le transformer, le générer, mais aussi à se créer elle-même en lui et par lui. Il s’agira de penser la manière dont le présupposé d’un livre écrit au miroir du monde est mis en crise par tout ce qui échappe à la spécularité, c’est-à-dire tout ce qui arrive au texte dans le processus du poiein, voire fait disparaître le référent au profit d’une intransitivité, d’un autotélisme du langage : la métaphore, l’image, le figural, l’implicite, la traduction, la polysémie, l’hermétisme, l’instabilité des signes, la subjectivité, la modalité, l’affect, l’expérience, l’indéterminé, le possible, l’imaginaire, le fabulaire. Autant de procédés ou de modes qui déplacent le régime référentiel et en dévoilent l’illusion.
— Numéro coordonné par Isabelle Alfandary, Priyanka Deshmukh et Juliana Lopoukhine
-
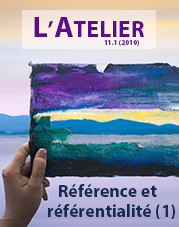
Référence et référentialité 1
Vol. 11 No 1 (2019)De quoi parle la littérature ? La littérature parle-t-elle de quelque chose ? La théorie aristotélicienne de la mimesis pose celle du rapport référentiel entre objet et représentation, entre monde et langage. Si pour Saussure le langage met fin au monde dans l’avènement ou la survenue du signe, est-il encore possible de dire qu’écrire, c’est décrire, ou même donner forme au monde, à l’expérience du monde ? Alors qu’il postule la préexistence d’un système de références stable comme pacte de lecture – lieux, événements, personnages, contexte historique et culturel – dont le texte littéraire se saisirait pour devenir l’espace métonymique d’un temps historique, le prisme référentiel tient-il encore face au pouvoir radical du langage, et à ce que ce pouvoir fait au monde ?
Ce numéro de l’Atelier souhaite interroger l’écriture comme médiation, comme ce qui arrive au monde, sa capacité à le transformer, le générer, mais aussi à se créer elle-même en lui et par lui. Il s’agira de penser la manière dont le présupposé d’un livre écrit au miroir du monde est mis en crise par tout ce qui échappe à la spécularité, c’est-à-dire tout ce qui arrive au texte dans le processus du poiein, voire fait disparaître le référent au profit d’une intransitivité, d’un autotélisme du langage : la métaphore, l’image, le figural, l’implicite, la traduction, la polysémie, l’hermétisme, l’instabilité des signes, la subjectivité, la modalité, l’affect, l’expérience, l’indéterminé, le possible, l’imaginaire, le fabulaire. Autant de procédés ou de modes qui déplacent le régime référentiel et en dévoilent l’illusion.
— Numéro coordonné par Isabelle Alfandary, Priyanka Deshmukh et Juliana Lopoukhine
-

L'Enthousiasme et son ombre
Vol. 10 No 2 (2018)L'enthousiasme, ainsi que nous le rappelle son étymologie, articule un transport, une énergie et un discours. Dans le monde grec, les figures privilégiées en sont l'oracle et le poète, le premier possédé, le second inspiré par la parole des dieux, comme en témoigne le dialogue entre Socrate et Ion. Comme si un certain régime de la parole, du discours voyait son ressort ne se donner à entendre que comme rapporté à des forces divines. L'enthousiasme est ainsi un transport dont est d'emblée marquée l'intensité, la force d'ébranlement, puisque s'y engage un pathos, qui dépossède autant qu'il possède. Il est indissociable du récit de sa double scène, celle du corps, des transes ou des fièvres qui l'accompagnent, et celle de la parole, de sa rhétorique, de ses accents et de son adresse. Il engage également un régime de la puissance dans son lien à la création, celle du temps ou d'une œuvre à venir. Il est de cette ferveur qui réapparait dans la puissance de création hors du commun qui caractérise le génie, dans les temps euphoriques de la manie, ainsi que l'évoque Aristote dans ses pages consacrées au génie et à cette ombre de l'enthousiasme qu'est la mélancolie. Il se conjugue au singulier ou au pluriel puisqu'une secte lui empruntera son nom pour désigner la ferveur religieuse sous le sceau de laquelle elle se place.
Il est également à articuler à la croisée de l'histoire et de la pensée politique, car il est au centre des crises politico-religieuses qui précèdent puis traversent les Lumières et se voit de ce fait placé sous les feux croisés de la critique philosophique. Ce dont témoignent ces débats, c'est que les lignes de différenciation selon lesquelles il est envisagé bougent : tout dépend des termes dans l'ombre desquels il est placé. En ce sens l'enthousiasme s'avère être un cristallisateur de questions épistémologiques et politiques majeures. Ainsi s'engagent sous la plume de Shaftesbury puis de Locke des débats sur les liens entre l'enthousiasme, la vertu, la connaissance. Ce qui est en jeu alors c'est l'enthousiasme comme faculté de la connaissance et moteur de l'action, en tant que registre d'une imagination visionnaire. Il peut s'y voir alors mesurer à l'aune de la raison, fût-elle don de Dieu, et mis au soupçon lorsqu'il témoigne d'une irrationalité enfiévrée ou d'une nature pathologique. L'enthousiasme, déjà distribué dans des sèmes divers dans les différentes langues, se voit alors affecté de différentes valeurs, tantôt au service du déchaînement des fanatismes et des folies meurtrières, tantôt s'alliant à la raison, à la volonté et à la pensée.
— Numéro coordonné par Sylvie Bauer et Chantal Delourme
-
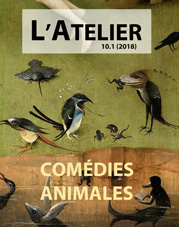
Comédies animales
Vol. 10 No 1 (2018)Finitude, captivité, pauvreté ontologique, silence, souffrance, exploitation, mort. À quelques importantes exceptions près, la tonalité dominante dans le champ encore jeune des études animales aura été mélancolique. L’animal qui naguère peuplait nos contes et nos fables est devenu désormais une figure pathétique, pour ne pas dire tragique.
Or, est-il encore possible aujourd’hui, serait-il éthique, de concevoir et de représenter les animaux sur le mode comique, comme le demande Ursula K. Heise ?
Ce numéro sera l’occasion d’interroger, au cœur et en marge du canon anglophone, les enjeux éthiques, politiques, épistémologiques et littéraires que soulève l’étude des comédies animales. On entendra dans l’écho balzacien de notre titre une invitation, non seulement à rendre aux mondes animaux l’architecture riche et complexe que La Comédie humaine empruntait à Cuvier pour son « histoire naturelle de la société », mais aussi à repenser ces mondes en relation dynamique et complice avec les mondes humains, comme nous l’enseigne l’éthologie.
— Numéro coordonné par Antoine Traisnel et Anne Ullmo
-

La Séduction de l'image 2
Vol. 9 No 2 (2017)Ce numéro, qui fait suite à "La séduction de l'image 1" (2016), interroge plus spécifiquement le pouvoir de séduction de l'image photographique et cherche à définir l’emprise singulière qu'elle exerce. Comment l'image photographique suscite-t-elle le désir et le maintient-elle inassouvi ? Comment parvient-elle à capter et saisir le regard du spectateur, au point de le dessaisir de sa capacité d’analyse ? Si l'image photographique fascine n'est-ce pas précisément parce qu'elle est porteuse d'un paradoxe, étant à la fois identique au réel et autre, écran sur lequel chacun peut projeter ses fantasmes ? Les articles réunis dans ce numéro tentent d'explorer ce paradoxe et de mettre au jour les stratégies de séduction déployées, par exemple, dans la pratique du selfie, qui joue sur cet écart entre la fonction indicielle de l'image et la mise en scène du geste photographique, entre présence et représentation, intimité et extimité, mais également dans les images de mode qui, à l'interface entre le sujet et le champ social, à la jonction entre tentation artistique et logique commerciale, alimentent un désir mimétique d'identification avec un modèle idéalisé et inaccessible. Tous cherchent à mettre en lumière les modes opératoires de la séduction photographique, séduction parfois instrumentalisée ou dévoyée lorsqu'elle sert la propagande d'état ou la domination coloniale.
— Numéro coordonné par Isabelle Gadoin et Marie Laniel
-

L'Idiotie
Vol. 9 No 1 (2017)Dans le champ de la littérature, l’idiotie est largement associée à un type de personnage ou une figure dont la récurrence souligne le pouvoir de fascination qui s’y attache. Qu’il soit considéré comme un simple, un naïf, un enfant attardé ou comme un être proche de la sauvagerie, l’idiot occupe un espace à part, en marge du corps social sans en être radicalement exclu ; il se tient dans une solitude « inférieure » que le jugement crée et, de là, interroge silencieusement la perception et l’appellation de cet autre supposément en position de le juger « idiot ». Victime expiatoire ou personnage conjuratoire, il se fait aussi figure dérangeante, subversive ou provocatrice lorsqu’il devient hors-la-loi institutionnalisé, autorisé à parler sans entraves, ou décline la notion d’idiotie jusqu’à en faire bouger le concept. La force de questionnement que génère l’idiot tient le plus souvent à son être même : l’idiot est ce corps étranger qui inquiète les limites de l’humain, ce point opaque et énigmatique qui, en dehors des projections imaginaires qu’il suscite (lien originel avec la nature, plénitude de l’être), n’a de cesse d’opposer sa résistance à l’appropriation et à la nomination. Indépendamment des personnages qui l’incarnent, l’idiotie peut s’envisager comme régime textuel, discursif ou narratif. L’on s’interrogera sur ce que pourrait être une écriture qui compose avec l’idiotie, en regard notamment de certaines expérimentations modernistes et postmodernistes qui mettent les modes d’intelligibilité classiques en déroute.
— Numéro coordonné par Amélie Ducroux et Pascale Tollance.
-
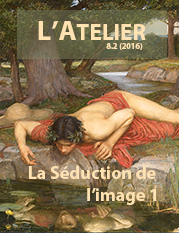
La Séduction de l'image 1
Vol. 8 No 2 (2016)Puissance de captation, de fascination, la séduction est ce pouvoir mystérieux et souvent incontrôlable qui s’exerce sur nous ou que nous exerçons sur autrui, par-delà tout raisonnement, tout système interprétatif figé, tout discours de vérité. Entre promesse et imposition, la séduction attire et effraye tout à la fois. Elle défie les catégories esthétiques : moins innocente que la grâce ou le charme, elle partage cependant avec eux une puissance étrange, qui peut paraître magique autant que maléfique. Distincte du simple plaisir esthétique lié à la contemplation du beau ou au réconfort de la mimésis, la séduction implique plutôt le sacrifice de la réalité et l’exaltation de l’apparence.
Si « séduire, c’est mourir comme réalité et se produire comme leurre » (Jean Baudrillard), alors l’image semble être un domaine de prédilection pour tenter de saisir la façon dont la séduction opère. Éprouver la séduction de l’image supposerait de renoncer à chercher en elle un au-delà des apparences, une vérité absolue, pour accepter de se livrer, au risque de se perdre, à son pouvoir de manipulation et goûter à l’attrait du superficiel. Ainsi l’image séduit-elle lorsqu’elle se fait délibérément illusion, lorsqu’elle nous fait éprouver la fascination du vide, crée le vertige, évoque la mort, l’imminence du désastre ou nous ouvre des abîmes métaphysiques. D’où la méfiance éprouvée par certaines cultures, certaines religions, envers l’image et son pouvoir de manipulation, de détournement, voire de dévoiement des signes. L’iconophobie ne serait-elle alors qu’une tentative de se prémunir contre le pouvoir de séduction des images ? L’iconophilie, une capitulation devant leur troublante puissance d’irradiation ?— Numéro coordonné par Isabelle Gadoin et Marie Laniel
-
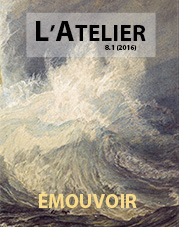
Émouvoir
Vol. 8 No 1 (2016)Que faire devant la puissance affective de l’œuvre littéraire ou plastique ? Comment articuler le logos critique avec l’expérience d’un pathos qui, tout en dépassant la compréhension, agit comme puissance motrice de notre désir de dire, d’écrire, de créer, de rendre compréhensible cette expérience elle-même ? Comment la littérature et les arts donnent-ils forme à l’émotion, et comment l’émotion à son tour travaille-t-elle leur forme ?
Ces questions impliquent le champ de l’expression, comme source ou ressource de l’œuvre, tout autant que celui de la réception, de la lecture. Elles engagent la relation d’un sujet — qu’il soit individuel ou collectif — à une expérience qui à la fois le déborde et le subjugue, car le mouvement d’émouvoir comprend simultanément action et passion. Aussi sa puissance implique dans le même temps une impuissance, produisant des effets souvent paradoxaux, voire contradictoires. La nature hétérogène des affects trouble dès lors l’expérience du temps linéaire ainsi que celle du corps où elle s’éprouve, avec des incidences sur l’œuvre qui tente d’en tracer les contours. Et lorsque l’on cherche à savoir qui est mu, par quoi, comment, et à quelles fins, rendre compte des formes de l’émotion appelle une pensée de l’histoire ainsi qu’une contextualisation à chaque fois singulière, afin de mieux en saisir les enjeux éthiques et politiques.
Autant de façons de se risquer à penser l’émotion, geste paradoxal qui met à l’épreuve les limites du savoir de et sur la littérature et les arts.
— Numéro coordonné par Juliana Lopoukhine et Naomi Toth
-
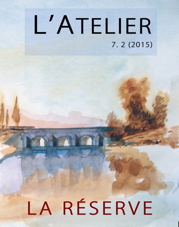
La Réserve
Vol. 7 No 2 (2015)Pourquoi amener à la lumière, comme choix d'objet pour ce numéro de la revue l'Atelier, ce qui précisément cherche, ou ne peut, que s'y soustraire, ce qui vient occuper cet étrange écart entre se laisser entendre et se dire, à savoir la réserve?
Pour cela même. Parce que la réserve en ses différents modes d'inscription a ce pouvoir d'interroger le dire, le sens, le voir et les modes par lesquels ceux-ci s'avancent, s'énoncent. Ce qui ainsi se soustrait, se retire du dire tout en laissant trace de son défaut, ou de son effacement sous ces formes multiples que sont le secret, le retrait, la réticence, la hantise, peut trouver sa place sur différentes scènes. La réserve peut s'exercer sous la forme d'un droit ou d'un devoir et ainsi engager certains enjeux de la question de la responsabilité. Elle peut prendre la forme d'un blanc, d'un espacement qui introduit à une dramaturgie toute singulière de ce qu'un tableau articule du donner à voir, du représentable et de ses conditions. Elle peut faire trace d'une certaine position subjective dans le dire que l'on associe à la pudeur, à la discrétion, mais étonnamment elle peut être aussi force de ressassement, de ressentiment, et lester ainsi le discours, le rapport au temps et à l'autre ("contre" qui la réserve s'exerce) d'affects singuliers. Elle peut encore constituer l'abord, ou la modalisation d'un propos théorique, philosophique, venant en inquiéter les seuils, la portée, ou bien au contraire en définir la condition même. Elle est également liée à un espace, celui de la thésaurisation, de la conservation, de l'élaboration, lequel peut fonctionner comme antichambre ou atelier de la création. En ce sens, elle renvoie aux conditions de genèse et à la production du texte comme archive.
Elle peut se déployer comme stratégie d'écriture, y compris dans la contrainte que le texte se donne à lui-même dans son économie générale. Elle renvoie à la fois à l'affect dont procède l'écriture et aux conditions formelles du texte ou du discours. Elle pointe donc vers les conditions de production, dans leur rapport au contexte, et les conditions de réception. On sera sensible à sa rhétorique (car elle a ses tropes - prétérition, concession, euphémisme-, sa syntaxe et sa ponctuation), aux effets paradoxaux de ses marques et de ses économies, mais aussi aux effets des discours positivistes qui voudraient se penser "sans réserve". Reste, résistance par laquelle le retrait fait signe d'un indécidable ou d'un sens à venir, elle semble avoir partie liée avec les pensées et les pratiques de l'interprétation.
— Numéro coordonné par Isabelle Alfandary et Chantal Delourme
-
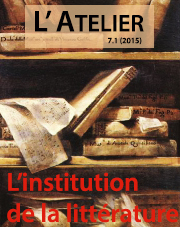
L'Institution de la littérature
Vol. 7 No 1 (2015)La question de savoir ce qu'est la littérature informe la pratique et la recherche des enseignants-chercheurs. Objet qui ne se laisse pas facilement saisir, qui ne se laisse pas forcer par des catégorisations, la littérature nourrit et fait la force des études universitaires, mais fait aussi l'objet d'enjeux économiques et politiques qui tentent de lui assigner une place, souvent mineure, dans la société. Produit commercial, comme en témoigne la floraison de "prix littéraires", instrument politique, considéré comme un "supplément d'âme", elle s'inscrit aussi dans des "programmes" scolaires et universitaires qui se disputent la légitimité de telle ou telle oeuvre, de tel ou tel écrivai. De fait, en dépit de son caractère hybride, mouvant, inassignable, elle devient istitutionnalisée en faisant l'objet d'une reconnaissance qui fait de certains textes un passage obligé des études secondaires et supérieures ou bien d'une méfiance envers des textes qui n'appartiennent pas au canon. On pourraît alors suggérer que l'institution - universitaire mais aussi politique et médiatique - fabrique tout autant la littérature que cette dernière ne se crée elle-même, ou tout au moins qu'elle se l'approprie, tente d'en dessiner les codes, d'en tracer le devenir, d'en faire un objet qui cesse de lui échapper.
— Numéro coordonné par Sylvie Bauer et Anne Ullmo
-
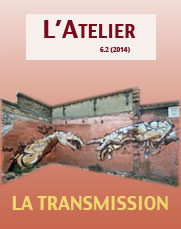
La Transmission
Vol. 6 No 2 (2014)Si la transmission connaît des formes libres et spontanées, si elle est parfois régulée ou codifiée, il lui arrive aussi bien souvent de chercher sa voie. Dans le champ du savoir (ou, singulièrement, là où le savoir est interrogé – par la philosophie ou la psychanalyse notamment), dans le domaine de la culture, des arts et de la littérature, la transmission ne manque pas de revenir sous forme de question : comment cela (se) passe-t-il ? Comment faire en sorte que cela passe ? Volonté d’œuvrer contre l’oubli pour que subsiste une mémoire, engagement à faire acte de témoignage, la transmission peut inversement prendre la mesure d’une perte irrévocable ou d’une impossibilité fondamentale à dire l’événement original qui inscrit l’écriture dans le jeu de la dissémination. En interrogeant la transmission dans ses pratiques, mais aussi dans ses tentatives de se raconter ou de se représenter, nous proposons de nous pencher sur les différentes modalités d’un passage qui compose avec le vide, négocie les transitions ou se joue des écarts.
— Numéro coordonné par Marie Laniel et Pascale Tollance -

L'Excès
Vol. 6 No 1 (2014)Dans l'acception courante, l'excès est presque toujours entendu de manière négative, comme ce qui dé-range, dé-borde, dé-passe. Il trouble les cadres qui permettent de comprendre autant que de produire l'œuvre, de quelque nature qu'elle soit : il en sort et menace de les faire céder. À l'inverse, l' excès peut également, sans contradiction, pointer un défaut dans ce qui ne peut le comprendre, le contenir — cela excède l'entendement, dit-on parfois. Ce qu'un champ donné, à un moment donné, ne peut saisir, laisse hors champ, peut fournir l'occasion d'une réflexion sur les contours définis, en vue de leur (re)définition ou de leur contestation. L'histoire des arts et de la littérature est-elle dès lors envisageable sans une pensée de l'excès en même temps qu'une pensée des bords de l'œuvre ?
— Numéro coordonné par Isabelle Gadoin et Richard Pedot
-
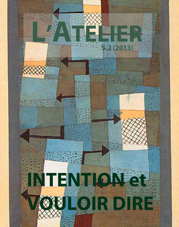
Intention et vouloir dire
Vol. 5 No 2 (2013)Dans la suite des numéros de L’Atelier consacrés à des notions clés de la critique littéraire, celui-ci souhaite mettre au débat les notions d’ « intention » et de « vouloir dire » comme notions dont les enjeux au sein des théories de l’interprétation demandent à être interrogés : et ce, aujourd’hui encore, voire aujourd’hui plus que jamais, dans des temps où l’on parle de « retour de l’auteur », de « retour de l’œuvre », des temps où des productions textuelles se fabriquent en réseau, où les revendications d’identité et d’autonomie dans leur urgence politique tendent à mettre sous le boisseau les complexités de la scène du sens, où enfin l’hypothèse de l’inconscient dans bien des domaines est remise en cause ou simplement balayée.
— Numéro coordonné par Isabelle Alfandary et Chantal Delourme
-
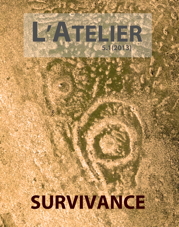
Survivance
Vol. 5 No 1 (2013)Résistance au « cours du temps », à « l'ordre des choses » ou à la mort elle-même, la survivance dit la capacité à endurer ou à perdurer contre toute attente. On peut voir en elle la manifestation de ce qui est littéralement « sur » ou au-dessus de la mort et échappe à toute négativité, ou plutôt un supplément de vie, un sursis qui tire sa force de la certitude ou de l'imminence d'un arrêt. « Le survivant survit toujours à la mort, mais à la mort de quelle vie ? » demande Jean-François Lyotard dans Lectures d'enfance. Ainsi à ce qui peut donner lieu à une mélancolie « préventive », le philosophe oppose-t-il la force du « tout de même » ou du « comme si », un « comme si » en lequel « l'enfance s'y connaît » – et en lequel la littérature a elle aussi un certain savoir ou savoir faire.
— Numéro coordonné par Pascale Tollance et Anne Ullmo
-

Poétiques du moment
Vol. 4 No 2 (2012)Définir le moment à l’aune de ses autres que sont l’instant, le présent, le contemporain dans ses élaborations poétiques. Entre « poétique » et « moment » opère une tension entre deux temporalités mutuellement exclusives, l’une relevant de l’élaboration, l’autre de sa suspension. Où la question est posée des formes et des genres littéraires et esthétiques qui peuvent accueillir — ou se trouveront déterminés par — l’exigence d’une écriture ou d’une représentation hors récit. Se penchant sur le moment dans sa dimension figurale aussi bien que fantasmatique, ce numéro interroge du même coup l’hétérogénéité temporelle et énonciative des œuvres.
— Numéro coordonné par Isabelle Gadoin et Richard Pedot
-

Le Malaise à l'œuvre
Vol. 4 No 1 (2012)Par malaise, qu’entend-on? Rien de définissable. Rien encore qui tombe immédiatement sous le coup du sens. Au contraire, le malaise met le sens en suspens et les positions en dé-route. Trouble moral et intellectuel, inconfort physique, le malaise est l’affect de l’indécidable. Ce numéro de L’Atelier n'offre donc pas une approche thématique, mais tente plutôt de mettre l’accent sur le lien du malaise à l’œuvre (littéraire, théâtrale, picturale, …) : sa traduction dans l’œuvre, le passage de l’un à l’autre et le malaise qui peut s’installer entre le lecteur/spectateur et l’œuvre.
— Numéro coordonné par Isabelle Alfandary et Richard Pedot