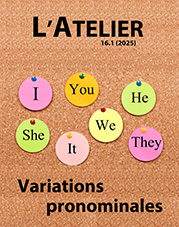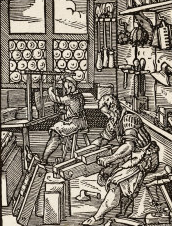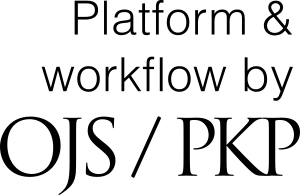La Langue éprouvée
Pour son numéro 17.2, à paraître en octobre 2026, la revue en ligne L’Atelier (https://ojs.parisnanterre.fr/index.php/latelier/index) lance un appel à contributions sur le thème « La Langue éprouvée ». Ce numéro sera coordonné par Amélie Ducroux.
Si la langue est partagée, l’expérience de la langue relève d’une intimité qui renvoie le sujet à sa propre fondation et à sa propre béance. Elle est, à cet égard, une expérience à nulle autre pareille, impliquant un relatif non-savoir et l’acceptation d’une certaine destitution. En tant qu’objet d’étude, la langue peut être analysée, décrite. En tant que matériau littéraire, elle est « éprouvée » d’une autre manière. La nécessité de défaire, déjouer, délier, peut s’imposer au poète, à l’écrivain tentant de faire entendre sa voix ou de faire sens autrement. La « langue éprouvée » peut impliquer « l’amour de la langue », pour reprendre le titre de Jean-Claude Milner, mais aussi un certain rejet de la langue et de ses contraintes. La langue elle-même est éprouvée en ce qu’elle est affectée par ce à quoi le sujet écrivant la soumet. Le lecteur est à son tour affecté par cette expérience toujours singulière consistant à lire, à entendre un.e autre s’exprimant dans sa langue. Il/elle pourra ressentir, par exemple, le déconfort que peut procurer ce que Roland Barthes nomme le « texte de jouissance » (« la langue en pièces »). Quant aux mots qui blessent, le texte littéraire ne peut que s’en saisir, rendant visible et audible l’indélébilité de la peine. En tant qu’inscription d’une langue éprouvée, le texte est toujours aussi un appel à éprouver la langue.
La langue éprouvée est aussi celle que les poètes au sens large ont à cœur de faire résonner quand elle semble appauvrie, usée, galvaudée, récupérée, quand la langue de tous, intime pour chacun, est atteinte par une forme de pouvoir ou une autre. Dire qu’elle est alors « éprouvée » n’a de sens qu’en considérant un sujet, lui-même éprouvé dans son rapport intime à sa langue. Mais la langue est aussi « éprouvée » par l’apport de l’autre, de l’étranger, de l’autre langue. C’est son hospitalité, sa plasticité, ses capacités d’hybridation qui sont alors mises à l’épreuve, la langue pouvant être altérée, affectée et enrichie par l’autre. Si la langue imposée (historiquement, culturellement) peut être perçue par le sujet comme ne lui revenant pas en propre, la langue dite « maternelle » n’appartient pas davantage à celui ou celle qui la parle. La formule de Jacques Derrida, « je n’ai qu’une seule langue et ce n’est pas la mienne » peut s’appliquer à tout rapport d’un sujet à sa langue dès lors que celle-ci est envisagée comme inappropriable. Le philosophe relie cette « expérience de la langue », à la fois singulière et universalisable, à « l’expérience de la marque », aux « stigmates », aux « blessures » et à la « passion » (Le monolinguisme de l’autre). C’est aussi parce que le sujet ne peut jamais la faire sienne qu’il éprouve la langue comme une altérité qui le traverse, remettant sans cesse en question l’idée de maîtrise.
Cette affection du sujet, que l’écriture du poète, de l’écrivain, expose plus ou moins ostensiblement, est intimement liée à ce que Jacques Lacan nomme « lalangue », qui « sert à de toutes autres choses qu’à la communication » et « désigne ce qui est notre affaire à chacun, lalangue dite maternelle, et pas pour rien dite ainsi. » (Le Séminaire. Livre XX, Encore) Le poète peut faire résonner ce qui soutient – inconsciemment – son usage « conscient » de la langue. En ce sens, la langue, ou « lalangue » est éprouvée à l’insu du sujet qui en est affecté et son écriture porte les traces de cette épreuve invisible. Elle peut être éprouvée en tant qu’elle affecte l’esprit, l’âme, mais aussi le corps. Ce que Julia Kristeva nomme « sémiotique » est détaché du « domaine de la signification » et c’est cette « motilité sémiotique » liée aux pulsions qui se donne à entendre dans certains textes de la modernité, sans pour autant « pulvériser » la « thèse du langage », le texte littéraire se distinguant, « comme pratique signifiante », du « discours du névrosé. » Le langage poétique, en particulier, ne cesse de « rappelle[r] ce qui fut depuis toujours sa fonction : introduire, à travers le symbolique, ce qui le travaille, le traverse et le menace. » (La révolution du langage poétique). Roland Barthes évoque, à la fin du Plaisir du texte, une « écriture à haute voix », portée par « le grain de la voix », qui ne serait pas « expressive » mais « appart[iendrait] au géno-texte, à la signifiance » : « […] ce qu’elle cherche (dans une perspective de jouissance), ce sont les incidents pulsionnels, c’est le langage tapissé de peau, un texte où l’on puisse entendre le grain du gosier, la patine des consonnes, la volupté des voyelles, toute une stéréophonie de la chair profonde : l’articulation du corps, de la langue, non celle du sens, du langage. » Cette « écriture à haute voix » qui, de fait, n’existe pas, est peut-être ce à quoi le poète, l’écrivain, aspire, lorsqu’il tente de se dégager de la seule expression.
Ce sont ces affections du sujet par la langue, ces motions qui traversent le sujet écrivant, mais aussi les « épreuves » subies par la langue, que nous souhaitons mettre en avant dans ce numéro de L’Atelier. Ce thème peut inviter à une réflexion sur le lien intime de l’écrivain ou du poète à sa langue, lien qui peut se donner à entendre dans des remarques, suggestions plus ou moins explicites au fil du texte mais aussi dans les effets repérables de répétition et de résonance. Il invite également à analyser le discours d’écrivains, de poètes (essais, entretiens) sur leur rapport à la langue ou aux langues, les termes auxquels ils/elles recourent pour décrire cette épreuve au sens fort ou cette aventure sentimentale et sensorielle. Il peut être l’occasion de réinterroger la réception du texte littéraire, l’expérience qui s’offre au lecteur, son aptitude à l’accueillir, les limites de sa réceptivité, voire sa résistance à cette expérience.
Les propositions d’articles (350 mots environ) sont à envoyer à Amélie Ducroux (a.ducroux@univ-lyon2.fr) avant le 15 septembre 2025. Les articles sont attendus pour le 15 janvier 2026.
Read more about La Langue éprouvée