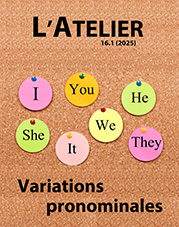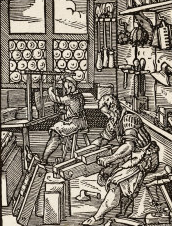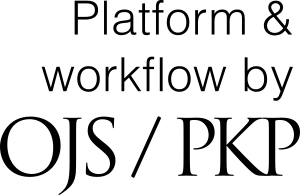À l'écoute : le côté obscur de la littérature, de l’art et de la pensée
“Qu’est-ce donc qu’être à l’écoute, comme on dit ‘être au monde’?” – J.L. Nancy, A l’écoute
“Where are we when we are listening?” – P. Sloterdijk, The Aesthetic Imperative
Il s’agira d’explorer l’impact du « tournant auditif » sur la pensée contemporaine : comment l’écoute, envisagée comme un mode paradigmatique de perception esthétique et de présence au monde, peut-elle constituer une contre-orientation critique à l’oculocentrisme qui domine depuis si longtemps la philosophie et la théorie occidentales ?
La métaphysique occidentale, fondée sur la vision, l’illumination et les Lumières, s’est constituée comme une méta-optique (Sloterdijk) : un sujet réflexif, né à la lumière de sa propre conscience parvient à la maîtrise de soi et du monde en saisissant la « manifestation lumineuse » de l’Idée (eidos), et en recourant à la théorie (θεωρία – theōria, thea, le regard tourné vers l’extérieur, horaō, regarder) pour dissiper l’obscurité des objets et tracer la voie vers la connaissance et le pouvoir. En dépit de décennies de critique déconstructive de ce « phallogoculocentrisme » (Derrida, Jay), les concepts critiques, du stade du miroir lacanien au « selfie » numérique, demeurent attachés à des paradigmes visuels qui associent la pensée à la lumière de la conscience réflexive et au regard analytique et pénétrant par lequel le sujet cherche à s’approprier le monde. Dans le contexte de la prolifération des sons et des images, et du « chaos discursif » de l’œuvre d’art à l’ère des médias du XXIe siècle (Krauss), nous nous interrogeons, à la suite de penseurs tels que Jean-Luc Nancy et Peter Sloterdijk, sur la possibilité que ces paradigmes visuels aient atteint leur limite historique. Peut-être est-il temps d’abandonner nos obsessions optiques et de nous tourner vers l’écoute, à mesure que nous pénétrons dans l’obscurité d’un territoire encore inexploré.
L’écoute peut être conçue comme l’« autre » ou le « côté obscur » de la théorie : une disposition qui déstabilise l’autonomie du sujet autoréflexif et ouvre une voie d’émancipation à l’égard des prescriptions esthétiques, historiques et culturelles issues de l’orientation visuelle et de l’appropriation du monde. Écouter, c’est s’aventurer dans un espace de désorientation, ces terres d’ombre où le clair et le distinct se dissolvent dans la résonance de l’insaisissable ; où l’immersion dans l’obscurité et l’« angoisse gaie » du non-savoir cher à Bataille éveillent à la fois les inquiétudes et les délices de la perte de soi dans l’œuvre ou dans le monde, loin de la quiétude des chemins sûrs et bien éclairés des idées nettes et des frontières disciplinaires.
L’écoute nous invite à interroger le côté obscur de la théorie à travers la littérature, les arts et la pensée critique. Elle ouvre la possibilité de nouvelles (dés)orientations conceptuelles, qu’il s’agisse d’examiner les positions, dispositions et représentations de l’écoute de/ l’écoute dans les œuvres littéraires, artistiques ou médiatiques, ou de concevoir l’écoute comme une disposition philosophique, critique et éthique, porteuse de la capacité à engendrer de nouvelles ontologies du soi, du monde et de l’œuvre.
Comment les explorations critiques guidées par l’écoute, la culture auditive, les études sonores et l’attention portée aux phénomènes auditifs non discursifs tels que la musique, le bruit, le silence ou les murmures, peuvent-elles servir à sonder les histoires, les styles, les formes et les matérialités de la littérature, de l’art et de la pensée, ou à mettre au jour des (dys)fonctionnements productifs des systèmes de langage et de discours ? Des murmures du romantisme (Adorno) au bruit moderniste et avant-gardiste (Kahn), des esthétiques du silence (Sontag) au bruissement de la langue de Barthes, des bégaiements deleuziens aux rires foucaldiens, en quoi l’écoute fonctionne-t-elle comme un opérateur critique susceptible de reconfigurer les frontières du sensible et du pensable ? Comment certains modes d’écoute se sont-ils accordés à des genres ou à des formes littéraires spécifiques — que l’on songe à la poésie du son (Perloff), à l’audition des voix dans le roman (Bakhtine), ou à l’écoute corporelle intégrale au théâtre (Janus) ; ou inversement, comment ces modes ont-ils été mobilisés pour perturber ou réorienter les frontières formelles, disciplinaires ou historiques ? L’écoute, envisagée comme suspension de la conscience de soi et immersion dans un espace résonant et échoïque, peut-elle relier les murmures de la rêverie romantique chez Wordsworth dans « The Boy of Winander » au bruit blanc et au bourdonnement des moniteurs d’Alvin Lucier dans « I Am Sitting in a Room » ?
Quelles désorientations méthodologiques émergent lorsque l’on conçoit la pensée, la lecture ou la vision comme des modes d’écoute qui impliquent, non pas de maîtriser l’œuvre comme objet, mais d’entrer en résonance avec elle et d’échanger la coordination œil-main de nos marteaux herméneutiques contre le diapason audio-tactile permettant d’en sonder les nouveaux accords ? Ainsi, les conceptions critiques récentes de l’écoute s’accordent à l’« autre » caché de la Mimesis (représentation), à savoir la Methexis (participation, performance) : participation au « texte littéraire comme instrument qui nous invite, nous, lecteurs à l’écoute, à le jouer selon la partition musicale de ses lettres » (Seel) ; participation encore à la performance « drastique » de la musique ou du théâtre (Jankélévitch, Abbate) ; ou à la résonance de l’image (W. J. T. Mitchell, Nancy), où nous sommes émus par et avec les mouvements formels et l’atmosphère de l’œuvre, comme dans une danse, fût-elle immobile. De la seconde oralité/auralité d’Ong et de McLuhan, à l’écoute gramophonique du « réel » chez Kittler, en passant par la clairaudience et le son imaginé dans la peinture, l’acousmêtre cinématographique de Chion, jusqu’aux nouveaux domaines du « cinéma aveugle » et les poétiques médiatiques de l’écoute comme médiation/im-médiateté (Boulter et Grusin) — l’écoute remet en cause la domination du visuel dans les Media Studies et la culture visuelle.
L’« autre » subalterne des paradigmes visuels en littérature, art et pensée, l’écoute déstabilise nos points de repères visuels et nous permet de nous tourner vers de nouvelles orientations esthétiques, éthiques et ontologiques. En tant que disposition orientée vers une esthétique de l’obscurité, l’écoute pourrait rouvrir à des concepts esthétiques qui privilégient « l’autre » des formes lumineuses, claires et distinctes à travers lesquelles l’art et la pensée « rassemblent et reflètent le logos et le mythos dominants de l’Occident » (Derrida, « La mythologie blanche ») : par exemple, les sombres dissolutions dionysiaques de Nietzsche, l’inquiétante étrangeté freudienne, l’« empirisme noir » de Sloterdijk, la Critique de la raison nègre de Mbembe, ou encore « l’informe assemblage » de l’esthésis noire liquide (Bradley). L’écoute avec « l’oreille de l’Autre » pourrait aussi nous permettre de nous accorder à de nouvelles résonances suscitées par la critique déconstructive du phallogoculocentrisme menée par les études queer et de genre (Cixous, Irigaray, l’écoute comme queering de la vision), par les études postcoloniales (Spivak, Bhabha) et par la psychanalyse (l’enveloppe sonore du moi-peau d’Anzieu antérieure au stade du miroir de Lacan).
Finalement, de nouvelles ontologies post-oculocentriques de l’écoute offrent un moyen de dépasser le cogito désincarné pour concevoir le soi comme un medium percussum (Sloterdijk) — un être incarné, immergé dans des relations de résonance avec d’autres formes d’êtres et de choses du monde (Nancy, Serres, Mitchell). Ce déplacement ouvre de nouvelles orientations dans les divers tournants affectif, néo-matérialiste, atmosphérique, écocritique, et post-humaniste de la pensée contemporaine, tous impliquant écoute, immersion et accord.
L’écoute de l’écologie profonde (deep ecology) (Abram, Serres), l’accord dans les esthétiques de l’atmosphère (Böhme), jusqu’à l’« étrange accord » de l’écologie sombre (dark ecology) de Morton. Cette conception ouvre la voie à une coexistence résonante avec des choses fragiles et finies, « baignées et entourées de nuées de non-savoir ». Elle conduit enfin à la disposition critique de l’homo ludens, « sombre et doux comme le chocolat », dont le rire joyeux et singulier accompagne la conscience inquiétante du non-humain installée au plus profond de l’humain.
Les propositions d’articles (350 mots environ) sont à envoyer à Adrienne Janus [adrienne.janus@univ-tours.fr] et Anne Ullmo [anne.ullmo@univ-tours.fr] avant le 15 février 2026. Les articles sont attendus pour le 15 juin 2026. Lire plus à propos de À l'écoute : le côté obscur de la littérature, de l’art et de la pensée